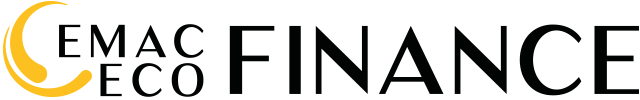L’UNESCO vient d’écrire la dernière page d’une aventure intellectuelle et éditoriale commencée il y a plus de six décennies. Le vendredi 17 octobre, au siège parisien de l’organisation, l’institution a annoncé l’achèvement des trois derniers volumes de son œuvre monumentale, l’« Histoire générale de l’Afrique », une entreprise unique visant à raconter le passé du continent du point de vue des Africains eux-mêmes.
Lancée en 1964 à la demande des États africains nouvellement indépendants, cette initiative visait à libérer le récit du continent des mythes et préjugés hérités de la colonisation. Soixante ans plus tard, le pari est tenu : onze volumes composent désormais cette somme historique sans équivalent, rédigée par plus de 750 chercheurs et intellectuels, majoritairement africains.
Trois nouveaux volumes pour compléter le récit du continent
Les volumes IX, X et XI viennent clore ce long chantier entamé en pleine période postcoloniale.
Le neuvième volume met à jour les connaissances accumulées depuis 1981, intégrant les avancées récentes de la recherche historique et archéologique.
Le dixième explore la dimension diasporique de l’Afrique, de la Mésopotamie du IXe siècle aux présences africaines plus récentes en Turquie, en Iran, dans la péninsule Arabique et dans les Amériques.
Le onzième, quant à lui, aborde l’Afrique contemporaine à l’échelle du monde : luttes de libération, panafricanisme, souveraineté, urbanisation, migrations, santé publique, égalité de genre et justice environnementale y sont traitées avec une ambition globale.
Ces trois tomes parachèvent une œuvre qui, au-delà du savoir, représente une réappropriation de la mémoire et un acte de souveraineté intellectuelle.
C’est en 1964, alors que le vent des indépendances souffle sur le continent, que les États africains demandent à l’UNESCO de produire un recueil d’histoire écrite depuis le continent africain. L’ancien directeur général de l’organisation, Amadou Mahtar M’Bow, résumait l’esprit de cette entreprise en une phrase devenue célèbre : “L’objectif n’était pas de réécrire une contre-histoire, mais d’établir une vision équilibrée, fondée sur les preuves africaines, qu’elles soient archéologiques, orales ou linguistiques.”
Pendant trente ans, d’éminentes figures du savoir ont contribué à ce projet : Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, Djibril Tamsir Niane, Ali Mazrui, Gamal Mokhtar, et bien d’autres. Entre 1981 et 1994, les huit premiers volumes voient le jour, constituant un tournant méthodologique majeur dans la manière d’écrire l’histoire du continent.

Une méthode pionnière et inclusive
L’« Histoire générale de l’Afrique » a bouleversé les cadres académiques traditionnels en intégrant des sources orales, manuscrites et linguistiques au même titre que les archives écrites.
Les manuscrits arabes et ajami deviennent des matériaux essentiels de l’histoire sociale, tandis que l’archéologie, l’épigraphie et la linguistique historique complètent la narration.
Cette approche pluridisciplinaire permet de revisiter des périodes jugées introuvables ou invisibles par les historiographies coloniales.
Le projet est aussi politique : il s’agit de rendre la parole aux peuples africains et de reconnaître la légitimité de leurs modes de transmission du savoir.
La seconde phase du projet, amorcée dans les années 2000, a connu un nouvel élan grâce à l’Union africaine. En 2009, elle appelle à prolonger l’entreprise afin d’y intégrer les événements récents.
Sous la présidence de l’archéologue camerounais Augustin Holl, le comité scientifique relance la production des volumes, mobilisant plus de 200 chercheurs issus de tout le continent.
En 2018, la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, donne une impulsion décisive au projet.
Elle en fait un instrument de transformation éducative autant qu’un monument de mémoire.
Malgré l’ampleur du travail, la diffusion de l’œuvre demeure un défi majeur. Les premiers tomes, souvent édités à Paris, n’ont pas toujours atteint les universités africaines ni les bibliothèques scolaires. Les nouveaux volumes entendent corriger cette situation grâce à une mise à disposition en ligne, à la traduction en langues africaines (kiswahili, haoussa, peul, etc.) et à la création d’outils pédagogiques.
L’UNESCO a ainsi lancé le Curriculum Pathway Tool, un outil de référence destiné aux ministères de l’Éducation et aux enseignants, permettant d’intégrer l’Histoire générale de l’Afrique dans les programmes du primaire et du secondaire.
Ce dispositif propose des plans de cours, des guides pour enseignants et des dossiers thématiques adaptés aux contextes locaux, qu’ils soient urbains ou ruraux.
Un projet tourné vers la jeunesse
Pour toucher les jeunes générations, l’UNESCO mise également sur le numérique et la culture populaire.
Le jeu vidéo « Héros africains », téléchargeable gratuitement, met en scène dix figures emblématiques du continent, parmi lesquelles la reine Nzinga, Toussaint Louverture ou Zumbi dos Palmares.
L’objectif : susciter la curiosité et l’attachement identitaire à travers des formes d’apprentissage ludiques.
Au-delà de son aspect éditorial, l’« Histoire générale de l’Afrique » est un projet de société.
Dans un continent où 60 % de la population a moins de 25 ans, replacer les savoirs africains au cœur des enseignements est un enjeu de stabilité, de cohésion et de développement.
Une jeunesse qui connaît son histoire peut se projeter dans l’avenir sans complexe ni dénigrement.
Comme le soulignait déjà Amadou Mahtar M’Bow, « il ne s’agit pas de faire l’apologie du passé, mais de le comprendre pour mieux bâtir l’avenir ».
Avec ces trois derniers volumes, l’Afrique reprend définitivement la main sur sa mémoire et se dote d’un outil pour façonner son futur.