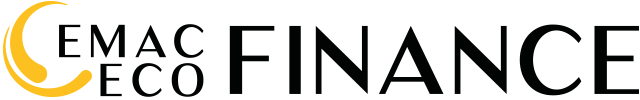La querelle de compétences entre la Commission Bancaire des États de l’Afrique Centrale (COBAC) et l’État du Cameroun soulève des questions juridiques complexes sur la gestion des fonds en déshérence au sein de la communauté de l’Afrique Centrale (CEMAC). Daniel Patriarche Dibongue, juriste fiscaliste et consultant en conformité bancaire, analyse les principes juridiques applicables en rappelant la chronologie des événements marquants de cette dispute, opposant souveraineté nationale et primauté du droit communautaire.

Pour mieux comprendre le contexte de cette « querelle » de compétence entre l’État du Cameroun qui revendique sa souveraineté nationale, et la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale la primauté du droit communautaire en matière de « fonds et valeurs en déshérence dévolus à la Caisse de Dépôts et Consignations» du Cameroun, nous nous proposons de rappeler brièvement la chronologie des évènements qui se sont succédés.
- 14 avril 2008, est publiée la loi régissant les dépôts et consignations au Cameroun
- 15 avril 2011, le décret portant organisation et fonctionnement de la Caisse de Dépôts et Consignations
- 20 janvier 2023, nomination du Directeur général de la Caisse de Dépôts et de Consignations
- 1er décembre 2023, le premier ministre du gouvernement camerounais publie le décret n°2023/08500/PM fixant les modalités de transfert de fonds et valeurs dévolus à la Caisse de dépôts et consignation
- 31 mai 2024 date butoir pour procéder au transfert des fonds et valeurs dévolus à la CDEC[1]
- 11 juillet 2024, le secrétaire général de la COBAC adresse une lettre circulaire aux banques, microfinances et établissements de paiement dans laquelle il leur demande de « sursoir au processus de transfert des avoirs en déshérence au profit de la CDEC ». Il estime à cet effet qu’un cadre règlementaire communautaire préalable doit être mis en place, pour clarifier la nature des avoirs en déshérence et définir non seulement les modalités de leur conservation, leur gestion, mais aussi de restitution.
- 1er aout 2024, le secrétaire général à la présidence du Cameroun réagit à cette lettre du secrétaire général de la COBAC en adressant une correspondance au ministre des finances dans laquelle il transmet les instructions du chef de l’État camerounais, l’invitant à « veiller avec la CDEC (…) à la poursuite effective, diligente et sereine du processus de transfert des fonds». Dans la même correspondance, le Secrétaire Général à la présidence invite la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale à « rapporter sa correspondance du 11 juillet 2024 relative à la suspension du processus de transferts des avoirs en déshérence, et d’axer ses réflexions sur les éventuelles activités bancaires résiduelles, susceptibles d’être exercées par la Caisse de dépôts et consignations, lorsque celles-ci n’ont pas créé des filiales à cet effet ».
De ces évènements, deux points de vue s’opposent : D’une part le régulateur bancaire communautaire estime qu’en l’absence d’un cadre juridique[2] sur le plan communautaire portant sur les fonds en déshérence, le Cameroun doit suspendre le transfert de ces fonds à la CDEC dans l’attente d’une normalisation communautaire. D’autre part, l’État du Cameroun à travers son Secrétaire Général à la présidence estime qu’il y’a atteinte à la souveraineté nationale de l’État du Cameroun, car non seulement il n’existe aucun fondement juridique permettant à la COBAC d’ordonner la suspension de transfert des fonds en déshérence dévolus à la CDEC, mais aussi la compétence de cette dernière n’est pas pour l’heure dévolue au régulateur bancaire communautaire[3]. Dès lors, le processus de transfert des fonds en déshérence doit se poursuivre tel que prévu par les textes nationaux camerounais.
La principale question juridique qui se pose face à ce qui s’apparente désormais comme une impasse, est celle de la concurrence des compétences entre l’État du Cameroun et la COBAC; en d’autres termes, qu’est-ce qui est prévu lorsque l’un des États membres de la CEMAC décide de légiférer sur une matière qui n’est pas spécifiquement prévue par les textes de la COBAC ? Autrement dit, en l’absence d’un cadre règlementaire communautaire, les États membres de la CEMAC sont-ils souverains d’appliquer leurs propres législations nationales ? Plus encore dans quelle mesure le décret du 1er décembre 2023 fixant les modalités de transfert des fonds et valeurs dévolus à la caisse des dépôts et consignation (CDEC) du Cameroun est -il compatible ou pas avec les compétences exclusives de la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) ?
L’analyse juridique nous permettant de répondre à ces questions s’articulera autour du rappel des principes de la primauté et d’harmonisation des législations communautaires d’une part, et des principes de la subsidiarité et de la complémentarité d’autre part. Et enfin, tout en analysant le statut juridique de la CDEC, nous envisagerons une solution qui respecte à la fois la souveraineté nationale et les principes communautaires.
Mais avant d’exposer ces principes chers à l’intégration et à la stabilité de la sous-région, il est judicieux de rappeler quelques faits historiques de la place qu’occupe le Cameroun au sein de la CEMAC.
En effet, la communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) constituent un cadre institutionnel et règlementaire destiné à harmoniser et superviser au sein des États membres de nombreux secteurs d’activités, notamment les secteurs bancaires et financiers.
L’adhésion du Cameroun à cette communauté des États est le résultat d’un processus historique marqué par plusieurs étapes importantes, partant des initiatives de coopération régionale[4], à la formation de la CEMAC[5]. En juin 1999, la CEMAC est ratifiée et devient officiellement opérationnelle avec le Cameroun comme membre fondateur.
Le Cameroun a toujours joué un rôle crucial dans la promotion de l’intégration économique et monétaire de la région[6]. Grâce à sa position stratégique[7], son économie diversifiée[8] son engagement constant, le Cameroun continue de contribuer au développement et à la stabilité de la CEMAC, tout en faisant face aux défis inhérents à l’intégration régionale. Et la question de la concurrence des compétences actuellement en discussion entre l’une des principales institutions de la CEMAC qu’est la COBAC[9] et le Cameroun revêt un enjeu majeur en terme de stabilité et de cohérence juridique au sein de la sous-région.
La primauté du droit communautaire et son application pratique
- Le principe de la primauté du droit communautaire
Le principe de la primauté du droit communautaire dans la zone CEMAC constitue une règle fondamentale qui établit la suprématie des normes et actes émanant des institutions communautaires sur les législations nationales des États membres. Il constitue une pierre angulaire de l’intégration régionale, assurant une intégration harmonieuse et efficace des textes et règlements applicables dans la sous-région de l’Afrique centrale.
Ce principe est consacré par le Traité de la CEMAC[10], les règlements et directives de la CEMAC et de la COBAC[11] et se caractérise par plusieurs éléments clés.
- La suprématie des normes communautaires
Les normes adoptées par les institutions de la CEMAC, telles que les règlements, directives, décisions et recommandations ont une portée supérieure à celle des législations nationales. A travers la suprématie des normes communautaire, les États membres se doivent de respecter et d’appliquer en primauté ces normes avant leur propres lois internes.
A titre d’illustration, en 2010 la CEMAC avait adopté un règlement sur la régulation des banques et institutions dans la région. Ce règlement attribuait à la COBAC des pouvoirs étendus pour superviser et réguler les banques dans toute la zone CEMAC. Avant l’adoption de ce règlement communautaire, chaque État membre, y compris le Cameroun[12], avait ses propres règlementations nationales concernant la supervision des banques. Certaines de ces règlementations étaient en conflit avec les nouvelles normes établies par la COBAC, elles ont dues être ajustées pour se conformer aux nouvelles normes communautaires à travers le processus d’ajustement législatif[13].
- L’application directe
Certaines normes communautaires, notamment les règlements, sont directement applicables dans tous les États membres sans besoin de transposition en droit national. En d’autres termes, non seulement les règlements s’appliquent immédiatement, mais ils deviennent contraignants dès leur adoption[14]. Grâce à l’application directe de la primauté du droit, les taux de TVA et les bases imposables ont été harmonisés dans toute la zone CEMAC dès l’entrée en vigueur du Règlement fixant les normes communes pour la TVA dans la CEMAC.
- L’obligation de conformité des législations nationales
L’article 44 du Traité révisé en 2003 impose implicitement aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre des obligations découlant du Traité de la CEMAC et des actes pris par les institutions communautaires. En cas de conflit entre le droit national et le droit communautaire, les États membres doivent modifier leur législation nationale pour la rendre conforme au droit communautaire.
- Le recours en cas de manquement[15]
Pour assurer le respect du droit communautaire, le Traité prévoit des mécanismes de recours auprès de la Cour de Justice contre les États membres qui ne respectent pas leurs obligations. Cette initiatives peut être prise par l’une des institutions de la CEMAC ou par un État membre.
- Le principe de subsidiarité et de complémentarité
L’un des principaux arguments avancés par le Secrétaire Général à la présidence du Cameroun pour remettre en cause la demande de suspension du transfert des fonds dédiés à la CDEC est l’absence pour l’heure d’un cadre règlementaire communautaire en la matière.
En effet, le principe de subsidiarité implique qu’en l’absence de règlementation spécifique de la COBAC, les États membres peuvent légiférer sur des questions non couvertes par les textes communautaires en adoptant lois nationales complémentaires. Cette flexibilité offerte aux États membres pour légiférer sur des matières non prévues par la COBAC est soumise aux garde-fous permettant de garantir la cohérence et l’uniformité des législations nationales avec le droit communautaire.
Dès lors au nom du principe de la subsidiarité, on est tenté d’affirmer avec le Secrétaire Général à la présidence que le Cameroun est libre d’appliquer sa législation nationale sur le transfert des fonds en déshérence à la CDEC, et la COBAC est d’ailleurs tenue de la faire respecter par les établissements de crédit.
Or en convoquant les objectifs et principes communautaires, les lois nationales prises en l’absence d’une règlementation communautaire doivent s’intégrer harmonieusement dans le cadre global de l’intégration régionale et du bon fonctionnement du marché commun. En d’autres termes, avant de promulguer des lois dans des domaines non expressément couverts par les textes de la COBAC, il est recommandé que les États membres consultent la COBAC, cette dernière pouvant fournir des avis ou des recommandations pour guider les États membres dans l’élaboration de leurs législations. C’est sans doute dans cet d’esprit que le Secrétaire Général de la COBAC invite les banques, microfinances et établissements de paiement à sursoir au transfert des fonds en déshérence à la CDEC[16] en attendant la clarification communautaire du régime juridique de ces avoirs.
En plus des principes de subsidiarité et de complémentarité, l’un des arguments supplémentaires avancés par l’État du Cameroun est que la CDEC n’est pas une institution financière soumise aux règles de la COBAC.

- Le statut juridique de la Caisse de Dépôts et Consignation du Cameroun
La CDEC est une institution publique consacrée par la loi camerounaise du 14 avril 2008 régissant les dépôts et consignations.
Il s’agit d’un établissement public de « type particulier »[17] , c’est-à-dire distincte de l’administration centrale assurant les missions d’intérêt général et obéissant à une règlementation particulière, ceci sous le contrôle de l’État[18].
Concrètement, les fonds reçus par la CDEC sous forme de dépôts, consignations ou garanties concourent au développement économique du pays à travers les intermédiaires spécialisés et selon les priorités définies par le gouvernement[19].
Au-delà, la CDEC est soumise à une règlementation particulière. En effet, bien que « gestionnaire de fonds », elle ne fonctionne pas comme un établissement commercial financier ordinaire au regard de ses missions, de son organe de tutelle et de son mode de financement. Les fonds perçus ne sont pas des dépôts des investisseurs ou des épargnants ordinaires, mais plutôt des catégories de consignations administratives, conventionnelles et même judiciaires[20].
Contrairement aux banques commerciales et institutions financières classiques de la zone CEMAC qui relèvent directement de la COBAC, la CDEC quant à elle est sous la supervision de l’État. Ses modalités de dépôts, de retraits de consignations ou de déconsignations sont fixées par voie règlementaire tout comme le taux et mode de calcul des intérêts des fonds dévolus à la CDEC[21]. Elle ne saurait pour l’heure être traitée comme établissement financier ordinaire tels que prévus par les dispositions de la COBAC[22]. Reste dès lors à voir comment concilier cette concurrence de compétences entre la COBAC et l’État du Cameroun en matière de transfert de fonds et valeurs en déshérence.
- L’application des principes communautaire aux fonds en déshérence
Au terme de l’analyse des dispositions communautaires de la COBAC et des lois nationales camerounaises concernant les fonds et valeurs en déshérence dévolus à la CDEC, il en ressort qu’en l’état actuel du droit communautaire, la gestion des fonds et valeurs en déshérence n’est pas directement de la compétence du régulateur communautaire. En effet, tout en exerçant un contrôle sur la Caisse de Dépôts et Consignations et en tant qu’établissement public à caractère spécial, l’État du Cameroun à travers la loi de 2008 et les textes règlementaires applicables en la matière a fixé les modalités de constitution et de gestion de ces fonds. De plus, le caractère spécial de cette institution est présenté dans les dispositions générales du Décret du 15 avril 2011[23] et laisse entrevoir que la CDEC n’est pas une institution financière ordinaire, comme l’est une banque, un établissement de paiement ( …) , mais plutôt un établissement public chargé de gérer les fonds publics et privés avec pour finalité l’intérêt général. Dès lors, en l’état actuel du droit communautaire, l’État du Cameroun serait à titre principal le seul compétent en matière de gestion des fonds et valeurs déshérence à travers la CDEC.
Mais dans un contexte communautaire[24] et même en l’absence de dispositions communautaires spécifiques, on ne saurait totalement exclure la COBAC de la question des fonds et valeurs en déshérence. En effet, étant donné que les fonds et valeurs à transférer à la CDEC sont logés ou transitent par les établissements de crédit, de microfinance et de paiement, eux-mêmes soumis au contrôle de la COBAC en tant qu’autorité de régulation[25], l’intervention de cette dernière serait alors justifier pour ne serait-ce que s’assurer du respect de l’application des lois et règlements en vigueur.
Une fois le contrôle exercé, les fonds transférés à la CDEC, la COBAC n’a en principe plus de compétence directe sur les fonds, son rôle se limitant à la supervision des établissements financiers avant le transfert des fonds, tandis qu’après le transfert la gestion des fonds serait de la compétence exclusive de l’État du Cameroun.
La question de la concurrence de compétences entre le régulateur communautaire et l’État du Cameroun en matière des fonds et valeurs en déshérence pourrait dès lors se régler à travers une combinaison de dialogue entre les parties, et une approche équilibrée dans laquelle l’État du Cameroun exerce sa compétence exclusive dans la gestion des fonds et valeurs dévolus à la CDEC, tout en respectant les engagements communautaires à travers le contrôle reconnus à la COBAC sur les établissements financiers.
[1] Caisse de Dépôts et Consignations du Cameroun
[2] Il s’agit selon la COBAC de la nature des avoirs en déshérence, de la définition des modalités de leur conservation, de leur gestion ainsi que de leur restitution.
[3] Pour cela, le Secrétaire Général à la présidence du Cameroun rappelle qu’il est prévu aux articles 3, 5 et 6 de la loi 2008/003 du 14 avril 2008 régissant les dépôts et consignations que les dépôts, consignations et séquestres judicaires ne peuvent être ordonnés qu’au profit de la Caisse des Dépôts et Consignations qui jouit d’un monopole concernant lesdits dépôts, consignations et séquestre.
[4] Cette étape a été marquée par la création en 1964 de l’Union Douanière Équatoriale (UDE) par le Cameroun, le Tchad, la République Centrafricaine, le Congo-Brazzaville et le Gabon, la Guinée Équatoriale avec pour objectif de promouvoir la coopération économique et commerciale.
En 1966, l’UDE a été transformée en Union Douanière Économique de l’Afrique Centrale (UDEAC). C’est elle qui a véritablement jeté les bases de la coopération économique et monétaire en Afrique Centrale.
[5] La CEMAC est née le 16 mars 1994 à Brazzaville, à travers la signature du Traité de Brazzaville signé par les chefs d’État de l’UDEAC. En remplaçant l’UDEAC, la CEMAC visait une organisation intégrée et plus efficace pour répondre aux défis économiques et monétaires de la Région.
[6] Le Cameroun a toujours montré un leadership fort et un engagement politique en faveur de l’intégration régionale. En tant que pays relativement stable et malgré la guerre dans la zone anglophone, le Cameroun continue de jouer un rôle crucial dans la promotion de la paix et de la sécurité, qui sont des prérequis pour l’intégration économique et monétaire.
[7] Situé au carrefour de l’Afrique centrale ; le Cameroun bénéficie d’une position géographique stratégique qui facilite les échanges commerciaux entre les pays de la région. Les ports de Douala et de Kribi sont des infrastructures majeures qui servent de points d’entrée et de sortie pour le commerce inter-régional, renforçant ainsi les liens économiques entre les États membres de la CEMAC.
[8] Le Cameroun a été à l’avant-garde de la promotion des réformes économiques au sein de la CEMAC. Le pays a adopté des politiques visant à améliorer le climat des affaires, à renforcer la gouvernance économique et à encourager les investissements privés. Ces réformes continuent d’avoir un effet d’entrainement sur les autres États membres, favorisant ainsi une convergence économique et monétaire dans la région.
[9] Traité révisé et signé par les 6 six chefs d’États membres le 30 janvier 2009 à Libreville
Voir le Titre I, article 1 du Traité révisé de la CEMAC : COBAC (Commission Bancaire de l’Afrique Centrale).
[10] L’art 1 du Traité consacré aux objectifs de la CEMAC énonce que la Communauté se fixe comme objectif l’intégration économique et monétaire. Et pour atteindre ces objectifs, il est implicite que les règles communautaires doivent primer sur les actes de droit interne des États membres.
[11] Ce traité établit les bases de l’union économique et monétaire et fixe les principes de l’harmonisation législative et de la primauté du droit communautaire.
[12] Le Cameroun avait par exemple une loi nationale qui permettait à ses autorités bancaires nationales de superviser directement certaines activités des banques locales, indépendamment des directives de la COBAC.
[13] C’est un processus qui consiste dans un premier temps à amender les lois nationales, ensuite une collaboration des États avec la COBAC pour le cas d’espèce pour s’assurer les nouvelles régulations nationales sont pleinement alignées avec les directives communautaires. Enfin la formation et l’adaptation aux nouvelles exigences de aux autorités locales.
[14] Avant l’adoption par le Conseil des Ministres du Règlement n°11/11-UEAC-190-CM-23 fixant les normes communes pour la TVA dans la région, les États membres avaient chacun des législations nationales distinctes en matière de TVA ; ces législations variaient considérablement en termes de taux de TVA, d’exemptions et de bases imposables avec pour conséquence les distorsions dans le marché régional. Mais conformément au principe de la primauté du droit communautaire, les États membres ont été tenus de modifier leurs législations nationales pour se conformer aux dispositions du règlement communautaire. C’est ainsi qu’à l’époque le Cameroun avait amendé son Code Général des Impôts pour adopter me taux de 18% et aligner les exemptions fiscales sur celles de définies par le règlement communautaire de la CEMAC.
[15] Voir article 4 du Traité révisé de la CEMAC en 2011.
[16] Voir la lettre circulaire du Secrétaire général de la COBAC adressée aux banques, microfinances et établissements de paiement le 11 juillet 2024.
[17] Cf. Article 3 de la loi du 1’ avril 2008 régissant les dépôts et consignations
[18] C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’article 12 de la loi prévoit que toutes les opérations de la caisse de consignations et de dépôts bénéficient de la garantie de l’État.
[19] Cf. Article 4 de la loi Op Cit.
[20] Cf. Art 5 de la loi Op. Cit
[21] Cf Article 8 et suivants
[22] Contrairement à ce que préconise le Fonds Monétaire International dans son rapport du 22 juillet 2024.
[23] Cf. Art 1 à 4 du Décret du 15 avril 2011, portant organisation et fonctionnement de la Caisse de Dépôts et Consignations : l’autonomie financière, la supervision et le contrôle par l’État du Cameroun, la règlementation spécifique et la mission d’intérêt général sont les élément qui particularisent cette institution des banques et établissements financiers classiques.
[24] Rappelant les principes, les valeurs et les objectifs d’intégration communautaire dans les Traité constitutif et révisé de l’ensemble de la CEMAC qui insistent sur l’harmonisation des règles nationales afin d’assurer une application homogène des règles communautaires.
[25] C’est d’ailleurs à ces établissements que s’adresse la correspondance du Secrétaire Général de la COBAC du 11 juillet 2024.
Par Daniel Patriarche Dibongue : Juriste fiscaliste – Consultant en conformité bancaire