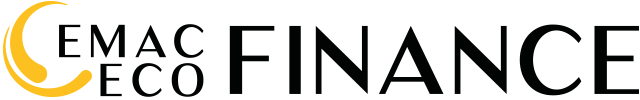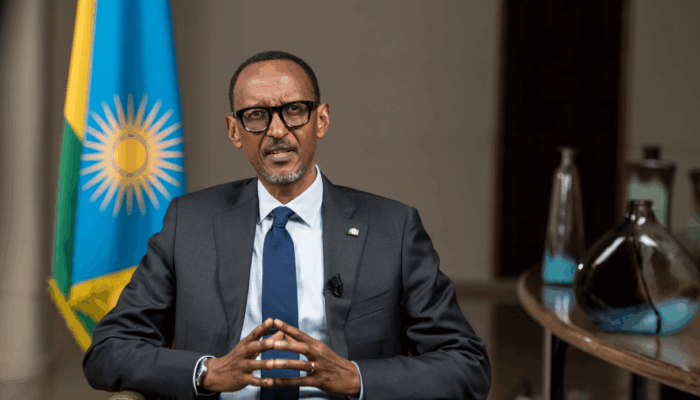Depuis la prise de Goma, le groupe armé contrôle l’exploitation du coltan et alimente les tensions géopolitiques
Depuis plusieurs mois, le Mouvement du 23 mars (M23), groupe armé soutenu par le Rwanda, étend son influence dans l’est de la République Démocratique du Congo (RDC). Après avoir pris la ville stratégique de Goma en novembre 2022, il a progressivement renforcé son contrôle sur les ressources minières du Nord-Kivu, notamment le coltan, un minerai essentiel à l’industrie des nouvelles technologies. La capture de la mine de Rubaya en avril 2024 a marqué un tournant décisif : le M23 détient désormais l’une des plus grandes réserves mondiales de coltan, représentant environ 15 % de la production globale.
Ce contrôle confère au groupe armé un levier économique puissant. En instaurant un système de taxation sur l’extraction et la vente du coltan, le M23 génère des revenus considérables, estimés à 800 000 dollars par mois. Ces fonds servent à financer ses opérations militaires et à consolider son emprise sur la région. En parallèle, le Nord-Kivu, privé de ces ressources stratégiques, subit des pertes mensuelles évaluées à 7 millions de dollars, aggravant une crise économique et humanitaire déjà alarmante.
Les experts des Nations Unies ont révélé l’existence d’une administration parallèle mise en place par le M23 pour gérer l’exploitation et le commerce du coltan. Désormais, les creuseurs et opérateurs miniers locaux doivent se soumettre aux règles dictées par le groupe armé, qui délivre des permis d’exploitation en échange de redevances. Cette mainmise ne s’arrête pas à l’extraction : le M23 contrôle également les routes menant aux frontières rwandaises et s’assure que le minerai extrait illégalement du Congo soit acheminé et intégré au marché international via le Rwanda.
Cette organisation bien orchestrée a conduit à la plus grande contamination des chaînes d’approvisionnement en minéraux 3T (étain, tantale, tungstène) enregistrée dans la région des Grands Lacs au cours de la dernière décennie, selon les Nations Unies. Le coltan congolais est ainsi mélangé avec celui produit au Rwanda avant d’être exporté sous une étiquette légale, échappant ainsi aux sanctions et contrôles internationaux.
L’implication du Rwanda dans ce réseau illégal alimente les tensions diplomatiques avec la RDC. Kinshasa accuse Kigali de fournir un soutien logistique et militaire au M23, ce qui exacerbe le conflit. En janvier 2025, la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies, demandant un embargo total sur les exportations de minerais rwandais, en particulier le coltan et l’or.
Malgré que la communauté internationale multiplie les appels à des sanctions et des mesures restrictives, la situation demeure complexe. Le commerce du coltan est occupé une place de choix dans l’industrie mondiale des technologies, et de ce fait, de nombreux acteurs économiques ferment les yeux sur l’origine exacte des minerais qu’ils achètent. Cette dépendance à des ressources extraites dans des zones de conflit empêche toute résolution rapide du problème.
Au-delà des enjeux économiques et géopolitiques, la mainmise du M23 sur le Nord-Kivu entraîne des conséquences dramatiques pour les populations locales. Les combats incessants avec les Forces armées de la RDC (FARDC) et les exactions commises par les groupes armés provoquent des déplacements massifs de civils. Des milliers de personnes ont fui leurs foyers pour se réfugier dans des camps où les conditions de vie sont extrêmement précaires.
L’insécurité chronique et le contrôle des ressources par des milices armées privent les habitants de leurs moyens de subsistance, alimentant un cercle vicieux de violence et de pauvreté. La guerre pour le coltan ne se limite pas à un affrontement militaire : elle détruit un tissu social et économique déjà fragilisé, plongeant le Nord-Kivu dans une instabilité durable dont les populations locales sont les premières victimes. À noter par ailleurs que le M23 a décidé de progresser vers Kinshasa.
Hélas, tant que ces ressources continueront d’alimenter les réseaux illégaux, la RDC restera prisonnière d’un conflit où l’exploitation minière devient un moteur de guerre plutôt qu’un levier de développement.