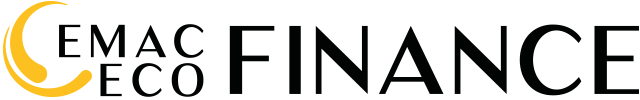L’Afrique n’imite plus, elle innove. Elle ne suit plus, elle inspire. Le dernier classement des 300 fintechs les plus florissantes au monde en témoigne clairement : dix entreprises africaines y figurent, aux côtés des géants asiatiques, américains ou européens. Elles sont jeunes, audacieuses, inclusives, souvent nées dans l’urgence de répondre à un manque criant d’infrastructures financières. Et désormais, elles font partie des leaders de la nouvelle finance mondiale.
Ces startups venues du Nigeria, du Kenya, de l’Afrique du Sud, de l’Égypte ou encore du Sénégal partagent une conviction forte : les problèmes structurels du continent sont aussi des opportunités technologiques. Paiements mobiles, crédit alternatif, scoring via les données, bancarisation informelle… autant de terrains où les fintechs africaines font preuve d’une créativité et d’une efficacité saluées bien au-delà du continent.
Flutterwave, fondée à Lagos, opère dans plus de 30 pays africains et facilite les paiements pour des géants mondiaux comme Uber ou Booking.com. Son PDG, Olugbenga Agboola, résume la philosophie du groupe en une formule saisissante : « L’avenir de la fintech africaine ne consiste pas à rattraper un retard, mais à inventer une autre façon de mener. »

À Accra et Kampala, Chipper Cash s’est imposée comme la référence des transferts d’argent transfrontaliers gratuits. Son cofondateur, Ham Serunjogi, souligne une ambition collective : « Nous construisons les rails financiers dont les économies africaines ont besoin pour grandir ensemble. »
Au Sénégal, Wave a bouleversé le marché en réduisant drastiquement les frais de transfert. L’idée fondatrice ? Permettre à tout le monde d’envoyer de l’argent avec la même facilité qu’un SMS. Une solution simple, pensée pour les réalités du quotidien, qui a conquis des millions d’utilisateurs en zone UEMOA.
En Égypte, MNT-Halan conçoit une super-application mêlant microcrédit, paiement mobile, transport et commerce. Son dirigeant, Mounir Nakhla, va plus loin encore : « Nous ne faisons pas que numériser la finance. Nous numérisons la vie des gens. » Ce sens de l’impact est omniprésent chez ces nouveaux acteurs du capital.
Yoco, en Afrique du Sud, équipe les petits commerçants avec des terminaux de paiement simples, accessibles, connectés à une application de gestion intuitive. Le pari de son fondateur, Katlego Maphai, est clair : « Rendre le commerce accessible à chaque entrepreneur africain. » Et les résultats sont là : plus de 200 000 TPE utilisent désormais ses solutions.
Les autres noms du palmarès – Paystack, TymeBank, Opay, Paga, Jumo – complètent cette galaxie innovante. Tous démontrent une même volonté : démocratiser la finance, la rendre fluide, mobile, rapide, et la mettre au service des populations longtemps négligées par les banques traditionnelles.
Ce classement envoie un message fort. D’abord aux investisseurs internationaux, qui regardent désormais l’Afrique non plus comme une zone de risque, mais comme un terrain fertile d’innovation. Ensuite aux régulateurs, qui doivent accompagner cette dynamique. Enfin, aux autres régions du continent, et en particulier à l’Afrique francophone, qui peine encore à faire émerger ses propres champions fintech.
Car si le Nigeria, l’Afrique du Sud ou l’Égypte brillent, la zone CEMAC reste absente du classement. Une situation qui n’est pas irréversible. Le potentiel est là : une jeunesse urbaine connectée, une forte appétence mobile, des besoins massifs en services financiers de base. Mais il manque encore un maillage structuré : fonds d’amorçage, incubateurs spécialisés, cadre réglementaire flexible, coopérations régionales fortes.
Faire émerger une licorne en Afrique centrale n’est plus un rêve inaccessible. C’est un enjeu stratégique. Pour cela, il faut libérer l’énergie des porteurs de projets, fluidifier l’accès aux financements, et créer les passerelles entre innovation, inclusion et développement économique.
L’Afrique, en matière de finance, ne rattrape plus son retard. Elle invente son propre modèle. Un modèle plus fluide, plus direct, plus humain. Et si demain, la norme mondiale s’inspirait de ce qui se fait aujourd’hui à Dakar, à Lagos ou au Caire ?