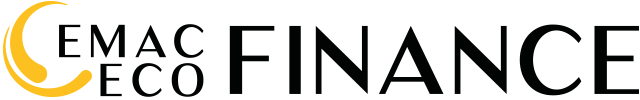Dans une conversation captivante, l’auteure et militante Djaïli Amadou Amal partage son parcours inspirant depuis ses débuts au Cameroun jusqu’à son engagement international pour les droits des femmes et des enfants. Elle nous dévoile les défis qu’elle a surmontés, ses motivations profondes et ses espoirs pour un avenir plus juste et équitable

Pouvez-vous nous raconter votre parcours littéraire et comment vous êtes devenue une voix importante pour les femmes du Sahel ?
Native de Maroua dans l’Extrême-Nord du Cameroun, ma première véritable expérience avec les livres remonte aux jours de mes huit ans, avec un roman jeunesse qui parle d’une forêt enchantée, d’elfes, de fées, et dont malheureusement je n’ai plus souvenance du titre. C’était un monde enchanté, je dirais magique, que je n’ai jamais quitté. Ma passion pour la lecture naît de ce livre. Dans le sillage de la passion pour la lecture, j’ai toujours écrit, dessiné. En fait, je tenais déjà un journal intime, mais l’expression littéraire s’est installée avec la prise de conscience des réalités sociales de ma propre société. Un long et sinueux cheminement qui mènera à mon premier roman, « Walaandé ; l’art de partager un mari », en 2010, primé à l’international et traduit en plusieurs langues. Suivront d’autres romans avec plusieurs consécrations, dont le prix Goncourt des lycéens en 2020. Pour l’essentiel, je dénonce les discriminations et violences faites aux femmes à travers les thématiques du mariage précoce et forcé, la polygamie et les pesanteurs socioculturelles.
Comment avez-vous justement ressenti le fait de remporter le prix Goncourt des lycéens pour « Les Impatientes », et quel impact cela a-t-il eu sur votre carrière ?
Une immense fierté bien entendu. L’impact est immédiat, aussi bien sur mon engagement littéraire que sur mon engagement militant. Les impatientes a connu une vente record en France et traduit en une trentaine de langues dans le monde. L’ouvrage est inscrit au programme scolaire au Cameroun et au-delà. Ce sont surtout là de nouvelles ressources qui ont renforcé les activités de mon association Femmes du Sahel avec, entre autres, la création de 2 bibliothèques à Douala et à Maroua. Mon nouveau statut d’ambassadrice de l’Unicef porte désormais ma voix à travers les plaidoyers à forts échos.


« Les Impatientes » aborde des thèmes puissants tels que la polygamie et la violence conjugale. Quelles ont été les réactions des lecteurs à ce sujet et quelles recherches ou expériences personnelles ont alimenté l’écriture de ce roman ?
Mes textes sont avant tout inspirés de faits réels. Ils sont à ce titre le produit de mes expériences sociales directes ou indirectes. Ils m’ont été inspirés des réalités sociales de mon environnement, des proches et connaissances au premier plan et, dans le cas précisément des impatientes, mon propre vécu aussi. Les réactions des lecteurs sont celles que nous connaissons généralement dans nos sociétés. Ceux qui critiquent négativement ne lisent pas généralement dans leur écrasante majorité. Les critiques courantes suggéraient que je suis contre les traditions ou encore contre l’islam. La dernière a pratiquement disparu avec le Choix Goncourt de l’Orient que j’ai remporté dans la foulée du Goncourt des lycéens et qui regroupe 10 pays arabes. Quant aux traditions, je souligne que sont là des considérations superflues quand il est question des sujets qui causent arbitrairement des souffrances à la femme. Soyons clairs, aucune tradition ne tienne dès lors qu’elle fait souffrir et aliène quelque composante de la communauté qu’elle caractérise. L’humanité et les droits de l’humanité sont universels et reposent sur des valeurs humaines qui sont elles aussi évidemment universelles. Aucune tradition ne peut se prévaloir au-dessus de ces valeurs. Et d’ailleurs, le temps qu’on y est, je précise que les traditions ne nous viennent pas du ciel et encore ! Elles nous viennent de nos ancêtres. Elles ont certainement évolué pour parvenir à nous sous la forme dont nous les concevons de nos jours. Celles qui étaient adaptées il y a des siècles ne le sont forcément pas aujourd’hui. Chaque génération, chaque communauté, dans un souci de progrès et d’épanouissement des siens, a pour mission de faire évoluer ses propres traditions pour les adapter à son époque. Une communauté qui ne sait pas faire évoluer positivement ses traditions est condamnée à sa propre déchéance. Et cette évolution ne sera possible que grâce à des personnes éclairées, animées des convictions humanistes profondes et éprises de la vérité que l’humanité, indépendamment de genre ou de couleurs, est unique et jouit strictement des mêmes droits. Pour le reste, « Les impatientes » fait désormais partie de l’univers socio-littéraire du Cameroun et dans bien des pays en Afrique et au-delà, avec l’impact que nous connaissons en termes de sensibilisation sur la condition de la femme.

« Cœur du Sahel » traite des croyances traditionnelles et des luttes de classes interethniques. Comment avez-vous équilibré ces éléments avec les réalités contemporaines de la vie au Sahel et quels impacts espérez-vous que ce livre ait sur la perception sociale dans cette aire culturelle ?
Il n’est pas ici question d’équilibrer ces éléments avec quelque réalité que ce soit. L’écrivain est le miroir de sa société. Un observateur de son temps. En ce sens, les événements, portés à travers son imagination, s’imbriquent les uns aux autres dans la dynamique de la trame romanesque qu’il développe.
« Cœur du Sahel » véhicule l’esprit de tolérance et l’acceptation de la différence en droite considération du vivre-ensemble, dont on sait le concept mis à mal cette dernière décennie dans nos pays du Sahel et bien au-delà, en Afrique et dans le monde.
Vos anciens livres, tels que « Walaandé, l’art de partager un mari », « Mistiriijo ; la mangeuse d’âmes », et « Munyal ; les larmes de la patience » ont également connu un grand succès. Pouvez-vous nous parler de leur influence sur votre écriture ?
Ces ouvrages ont pour dénominateur commun la thématique de la condition de la femme. Chacun porte un regard sur quelque aspect de cette condition avec une sensibilité plus ou moins spécifique. C’est l’alliage des deux qui fait la particularité de l’ouvrage. Ceci étant, la constance reste mon style d’écriture, faisant de la langue un support de ma culture peule.
Qu’est-ce qui vous a inspiré à écrire « Le Harem du Roi » et pourquoi avez-vous choisi ce titre ?
L’environnement du lamidat, ainsi qu’on appelle les chefferies traditionnelles de premier rang notamment dans le Nord-Cameroun ou le Nigéria, a été toujours omniprésent dans mon esprit. Mais c’est aussi un environnement mythique, clos et redouté. Nous ne savions pas toujours ce qui s’y passe, sinon par quelques bribes plus ou moins précises. C’est un univers qui, finalement, depuis mon adolescence, m’a toujours fascinée sans que je daigne y mettre pied. Le destin d’une de mes camarades de classe devenue épouse du roi n’a fait que renforcer ma sensibilité sur l’idée d’explorer la condition de la femme dans ce bastion garant des traditions et de la religion. Le titre parle de lui-même. J’ai décidé d’écrire un roman dont les personnages sont les femmes qui partagent l’intimité du roi. Qui sont-elles ? Que ressentent-elles et quels sont leurs motivations et leurs espoirs ?
Pouvez-vous nous parler des personnages principaux de « Le Harem du roi », Boussoura et Seini, et de leurs dynamiques dans l’histoire ?
Il s’agit d’un couple de médecin et d’une professeure de littérature qui filait le parfait amour, et une famille épanouie, jusqu’à ce que Seini décide de devenir roi. Si Boussoura a à cœur de sauver son couple face à l’immiscion de la tradition avec ses pesanteurs et la mise à mal de ses acquis, Seini, lui, est désormais accaparé par ses prérogatives de lamido et les responsabilités qu’il entend assumer. Dès lors, le fossé n’a de cesse continué de se creuser entre eux.
Comment avez-vous abordé les thèmes de la tradition et de l’émancipation féminine dans « Le Harem du roi » et quels défis avez-vous rencontré en écrivant ce livre ?
Le fil directeur a été la relation entre Seini et Boussoura et l’évolution de cette relation au gré des tumultes qui, irrémédiablement, éloignaient l’un de l’autre. L’environnement royal, comme je l’ai dit tantôt, m’était étranger. Et c’est sans doute le plus grand défi auquel j’ai fait face, réussir à me l’approprier à travers mes recherches et les témoignages déterminants susceptibles de me procurer la sensation d’immersion que je recherchais préalablement. Cela est très nécessaire pour produire des à forte sensibilité.
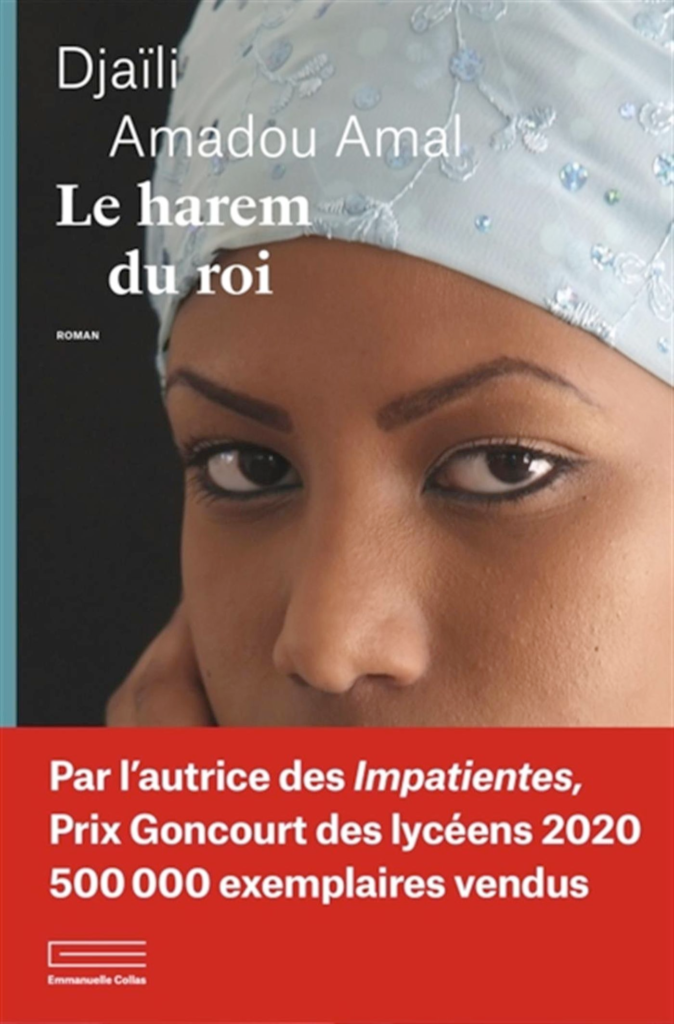

Quel message espérez-vous transmettre à travers « Le Harem du roi » et y a-t-il des éléments autobiographiques ou des expériences personnelles qui ont influencé l’écriture de ce livre ?
Il y a toujours une part de soi dans un roman. Mon engagement féministe résulte de mes expériences personnelles et, à ce titre, il va de soi que celles-ci ont influencé l’écriture non pas seulement du Harem du roi, mais aussi de l’ensemble de mes œuvres littéraires à ce jour.
« Le Harem du roi » pointe du doigt les effets néfastes de certains aspects de la tradition sur la condition de la femme. Au rang desquels la persistance de la servitude dans un contexte où l’esclavage est officiellement aboli. D’autre part, nous voyons aussi progressivement comment le pouvoir a transformé un homme bien, animé de la bonne volonté de faire évoluer positivement les choses mais qui finira par perdre des valeurs et désagréger sa cellule familiale auxquelles il était pourtant attaché.
Quel est votre plus grand rêve en tant qu’écrivaine et militante, et quels sont vos projets futurs pour l’évolution de votre engagement pour les droits des femmes ?
Mon plus grand rêve ! Imaginez d’où je viens et le chemin accompli, et vous pouvez par vous-même esquisser une réponse à votre question(rires). En termes de projets, je poursuivrai mes publications autant que possible, en même temps que je mènerai à travers mon association les activités sociales en faveur de l’éducation et la condition de la femme, au nom de mes convictions intellectuelles et militantes. Pour le reste, mon engagement pour le droit des femmes reste dynamique et évoluera en fonction des nouvelles donnes qui habiteront mon cheminement.
Nous vous remercions encore pour votre temps et pour avoir partagé avec nous votre vision et votre travail. Nous vous souhaitons un franc succès pour « Le Harem du Roi » qui continuera à toucher et inspirer les lecteurs.
Interview réalisé par Blaise Pascal TANGUY